Un article de Mediapart partiellement inspiré des engagements d'Actuchomage (1).
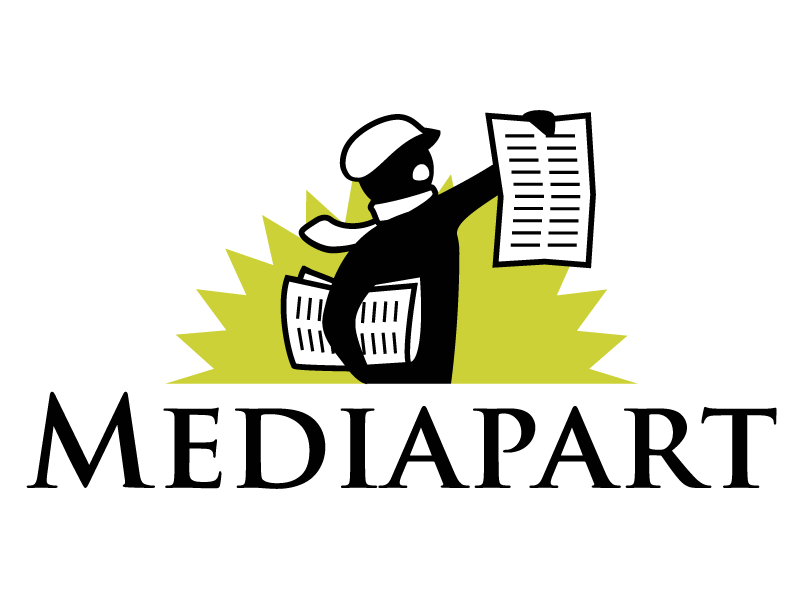 Au moins cinq conseils départementaux refusent d’attribuer le RSA aux Français disposant d’un certain montant d’épargne. Rien dans la loi ne les y autorise, comme l’a rappelé en 2019 le Conseil d’État.
Au moins cinq conseils départementaux refusent d’attribuer le RSA aux Français disposant d’un certain montant d’épargne. Rien dans la loi ne les y autorise, comme l’a rappelé en 2019 le Conseil d’État.
Limiter la «fraude sociale», encore et toujours. Ces tout derniers jours, la Cour des comptes et un rapport parlementaire se sont penchés sur les arnaques aux prestations sociales, qui peuvent viser les caisses d’assurance-maladie et d’allocations familiales ou Pôle emploi. Le directeur général de la Caisse nationale d’allocations familiales a de son côté promis de muscler encore les contrôles.
Derrière cet unanimisme à forte résonance médiatique, qui vise à empêcher de profiter indûment des aides sociales financées par le contribuable, se cachent d’autres situations problématiques, bien peu mises en lumière alors qu’elles sont illégales. Alix* (les prénoms ont été changés) l’a appris à ses dépens il y a quelques mois.
En début d’année, l’allocataire avait touché 415 euros mensuels pendant deux mois au titre du RSA (revenu de solidarité active). Mais au printemps, un courrier du conseil départemental de la Manche lui a indiqué que la somme ne lui serait plus versée. Motif ? «Le montant des capitaux détenus actuellement par votre foyer dépasse 23.000 euros.»
Depuis une délibération du 17 juin 2016, le département a en effet instauré un seuil de détention de capitaux, au-delà duquel le RSA, financé par les départements et distribué par les CAF, n’est plus versé. Au moins quatre autres départements appliquent une politique similaire, sans qu’à notre connaissance elle n’ait jamais été détaillée par un média. Les seuils retenus varient d’un département à l’autre, allant du simple au quintuple.
«En Bretagne, entre deux emplois précaires, j’avais déjà été bénéficiaire du RSA pendant quelques mois. J’ai donc eu du mal à comprendre pourquoi on me privait d’un droit cette fois, témoigne Alix. D’autant que j’étais en train de lancer ma propre entreprise dans le domaine médico-social, après avoir épuisé mes droits Pôle emploi sans retrouver de travail : j’étais tout à fait dans une démarche d’insertion et de retour à l’emploi.» Le RSA est censé «lutter contre la pauvreté», «encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle» et «aider à l’insertion sociale des bénéficiaires».
«Les élus ont souhaité mettre en œuvre une loi qui permet de dépenser chaque euro de la solidarité pour les personnes qui en ont prioritairement besoin, c’est-à-dire celles qui n’ont jamais eu l’opportunité d’épargner ou d’hériter», explique à Mediapart le conseil départemental de la Manche pour justifier sa délibération de 2016, adoptée (sans vote s’y opposant) au nom «des équilibres entre les citoyens».
En interdisant de RSA les citoyens disposant de plus de 23.000 euros placés (sur des livrets, une assurance-vie ou un PEL), le département dirigé par Marc Lefèvre (divers droite) entend les encourager «à recourir à leur propre épargne». En 2019, le conseil départemental a signifié 70 refus, pour 7.432 foyers bénéficiaires.
«Pour moi, il s’agissait d’une épargne de précaution, d’anticipation, témoigne Alix, qui disposait d’un peu plus de 23.000 euros en banque. J’ai déjà été au Secours populaire quand j’étais jeune, et je me souviens aussi des coupures d’électricité subies avec mes parents. Depuis, je m’astreins à gérer mes ressources pour ne pas me retrouver dans la mouise, pouvoir réparer ma voiture, et même, pourquoi pas, payer des études à mes enfants.» Cette épargne de précaution, on la lui fait payer, au sens propre.
Il pourrait s’agir d’un épiphénomène, mais il n’est à la vérité pas si anecdotique. Car il est illégal : rien dans la loi de 2008 instaurant le RSA en remplacement du RMI (revenu minimum d’insertion) ne prévoit une telle disposition, ni n’autorise les départements à la mettre en œuvre.
C’est d’ailleurs ce qu’a jugé le tribunal administratif de Caen, dans une décision du 1er février 2019 où il a annulé un précédent refus du département d’attribuer le RSA en raison du dépassement du seuil de 23.000 euros d’épargne. Ce jugement a été confirmé le 6 novembre par le Conseil d’État, qui a rejeté le recours du conseil départemental.
Dans son argumentation, le tribunal rappelle que la législation prévoit que le droit au RSA dépend de la prise en compte de tous les revenus du demandeur, dont ceux issus de l’argent placé sur des comptes : il faut comptabiliser les intérêts annuels générés par les livrets d’épargne, et considérer que les placements ne rapportant pas d’intérêts rapportent l’équivalent de 3 % annuels – ce qui a par le passé entraîné d’autres irrégularités, que Mediapart a détaillées ici et là.
Mais il n’est en rien prévu de prendre en compte l’intégralité des capitaux placés. La délibération du département de la Manche «ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire applicable au revenu de solidarité active», a donc tranché le tribunal, appuyé neuf mois plus tard par le Conseil d’État, instance suprême de la justice administrative.
Ce camouflet judiciaire n’empêche pas le département de continuer à appliquer sa politique. Au prix d’un raisonnement juridique pour le moins acrobatique. «Le décret [d’application] sur lequel s’appuie la décision du Conseil d’État est venu déconstruire la volonté du législateur en vidant la loi de sa substance», assure le service de communication de la Manche. Le département «a donc introduit un recours gracieux auprès du premier ministre sur ce décret». Et «tant que le premier ministre ne répond pas à ce recours pour lequel nous l’avons déjà relancé, la délibération du département reste applicable», assure l’institution locale, qui estime être «dans son bon droit».
«Après ces décisions judiciaires, le département aurait dû prendre acte que sa position n’est pas fondée en droit, regrette l’avocat caennais Nicolas Toucas, qui a obtenu le jugement du tribunal administratif et vient de déposer un nouveau recours sur un autre dossier. En ne le faisant pas, il met de façon tout à fait illégale des personnes en grande difficulté. Et ce n’est pas le seul département à agir ainsi.»
En effet, l’initiative n’est pas isolée. Au nom du «juste droit» – notion à la mode dans les collectivités locales dirigées par la droite – au moins deux autres départements de la région Normandie, l’Eure et l’Orne, appliquent la même politique, avec des seuils de capitaux différents. Et un troisième, le Calvados, a voté sa mise en place sans jamais l’appliquer. L’association Apnée, qui gère le site Actuchomage, très active dans la défense des allocataires de Pôle emploi et des divers minimas sociaux, ajoute l’Hérault et les Pyrénées-Orientales à cette liste.
«Faute de temps et de bénévoles, nous n’avons ciblé que les départements qui sont le plus cités dans nos forums, mais nous n’avons en fait testé que peu de départements, et la plupart ne répondent jamais à nos sollicitations», souligne Stéphane, bénévole de l’association, qui conseille les internautes sur Actuchomage sous le pseudonyme de «Zorro22».
Très peu de contestations devant les tribunaux
Aussi étrange que cela puisse paraître, il n’existe pas de liste officielle de départements refusant d’attribuer le RSA pour cause d’épargne jugée trop élevée. Ou au moins les divers ministères sollicités par Mediapart n’ont pas été en mesure de la fournir. «Le ministère des solidarités et de la santé et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se refilent le bébé, et le tout finit généralement dans un tiroir», grince le bénévole.
Un tout récent ministre chargé des relations avec le territoire connaît pourtant bien la question. Aujourd’hui ministre de l’Outre-mer, Sébastien Lecornu était encore président du conseil départemental de l’Eure lorsque l’assemblée locale a voté la mise en place de cette politique, le 15 mai 2017. L’Eure a instauré le plafond le plus faible, considérant que toute personne détenant 9.670 euros de capitaux placés n’avait pas besoin du RSA. Pourquoi ce seuil ? Parce qu’il correspond «à 18 fois le RSA de base d’une personne seule», indique la délibération de mai 2017, signée par Sébastien Lecornu. Ni ce dernier ni le conseil départemental n’ont souhaité en dire plus à Mediapart.
Dans le département voisin de l’Orne, c’est le seuil de 15.000 euros qui a été retenu en novembre 2014, en annexe d’un «plan de prévention des indus et de maîtrise des dépenses». La collectivité locale indique qu’en 2019, seuls 27 dossiers ont été refusés au nom de cette mesure.
Toujours en Normandie, le Calvados a instauré en décembre 2016 un seuil de 30.000 euros. «C’était une manière de s’assurer que les moyens des pouvoirs publics, limités chacun le sait, aillent bien à ceux qui en ont le plus besoin, explique le département. Le risque autrement est de porter le flanc à des critiques sur la soutenabilité globale des aides sociales dans notre pays.»
Plus prosaïquement, les départements soulignent – à raison – que financer le RSA leur coûte cher, car l’État, qui leur en a attribué le financement, ne compense pas les sommes dépensées pour cette prestation sociale. Les exécutifs locaux estiment qu’en moyenne, seuls 50 à 60 % des sommes dépensées sont remboursées par l’État.
La Manche, l’Orne et le Calvados ont d’ailleurs obtenu en juillet une retentissante décision du tribunal administratif de Paris : l’État a été condamné à compenser intégralement les hausses du RSA qu’il a décidées entre 2013 et 2017. Les conséquences pourraient être importantes. Si l’État devait rembourser tous les conseils départementaux, il devrait payer 4 milliards d’euros.
Dans le Calvados, la mesure n’a en fait jamais été mise en œuvre. Le temps de formaliser l’accord avec la CAF, «nous sommes entrés dans un “état d’urgence social” qui demande toute notre attention pour accompagner les allocataires du RSA et notamment les nouveaux entrants», indique le conseil départemental sans plus de précisions.
Ailleurs en France, les Pyrénées-Orientales rejettent les demandes de RSA «pour les personnes ayant des capitaux placés ou non placés de plus de 23.000 euros (personne seule) ou 46.000 euros (pour un couple)», indique le département. La majorité PS-PCF «considère que ces personnes ne sont pas en situation de pauvreté et disposent de moyens convenables d’existence». Cinquante dossiers ont été rejetés ou radiés en 2019.
Selon les éléments recueillis par Apnée/Actuchomage et Mediapart, l’Hérault est le département ayant instauré le plafond le plus haut, à 50.000 euros, correspondant «approximativement à deux fois le plafond d’un livret A» (qui est de 22 950 euros). «Depuis 2015, une quarantaine de dossiers ont été concernés par des rejets à l’ouverture du droit ou à des radiations en cours de droit, entre 55.489 et 435.949 euros», détaille le conseil départemental. Ce dernier précise avoir «maintenu le droit de l’ensemble des allocataires du RSA, sans étude du niveau de ressources» pendant toute «la période Covid».
Le département assure surtout avoir fait face à peu de contentieux, et avoir toujours obtenu des décisions favorables du tribunal administratif, «pour non-déclaration de ressources et absence de précarité» des allocataires. La collectivité territoriale n’a pas précisé si ces décisions avaient été prononcées avant la décision du Conseil d’État.
«Dans tous les cas, peu de personnes se lancent dans les contestations juridiques qui sont très lourdes, regrette l’avocat Nicolas Toucas. Avant d’arriver au tribunal, il faut d’abord faire un premier recours administratif, qui n’aboutit en général pas, puis la procédure dure un an.»
François* est de ceux qui ont lancé une procédure, après un refus de RSA en raison de son épargne. Ce refus a été jugé abusif par l’assistante sociale qui suit son dossier, et qui l’a incité à demander un recours gracieux au département. Sa demande ayant été rejetée par l’institution, il a lancé l’action en justice il y a de longs mois. Il attend encore son aboutissement.
«Parallèlement, j’ai tenté d’évoquer ce problème auprès d’élus locaux, raconte François. En vain : cela n’a suscité aucun intérêt, si ce n’est celui d’un collaborateur du député de ma circonscription. Après un rendez-vous obtenu au forceps, ce dernier m’avait promis de revenir vers moi prochainement. C’était il y a plus d’un an, et malgré plusieurs relances, j’attends toujours de ses nouvelles.»
Philippe*, indépendant dans le domaine de l’informatique, a quant à lui renoncé à défendre son droit. «J’ai toujours travaillé et payé mes cotisations. Lors d’un changement d’activité début 2018, j’ai subi une forte baisse de mon chiffre d’affaires, se remémore-t-il. Quand j’ai fait une demande de RSA, j’ai d’abord obtenu une réponse positive, m’indiquant que le président du conseil départemental validait mon dossier. J’ai touché 315 euros, une fois. Et puis, j’ai reçu une nouvelle réponse, négative cette fois, mais sans aucune précision. Les versements ont cessé, et on m’a repris les 315 euros en ponctionnant ma prime d’activité.»
Philippe assure n’avoir jamais reçu d’explication officielle. «Au téléphone seulement, un agent du conseil départemental m’a expliqué que je n’étais pas dans le besoin, que je n’avais qu’à demander de l’argent à des amis, indique-t-il. Alors que j’avais justement constitué mon épargne pour pouvoir me relancer en cas de coup dur et ne pas rester dépendant trop longtemps.»
Mais la lourdeur des procédures l’a découragé d’aller plus loin. «Il aurait fallu prendre un avocat, faire un recours administratif, j’ai laissé tomber, dit-il. Mais c’est absurde, si j’avais déménagé, j’aurais pu toucher le RSA. Et on ose parler d’égalité des droits sur le territoire national…».
Selon nos informations, le Défenseur des droits est justement en train d’examiner un dossier de ce type pour évaluer si l’accès au RSA est assuré partout en France, comme le prévoit la loi.
DAN ISRAEL - MEDIAPART
(1) Article partiellement inspiré des engagements d'Actuchomage et de son référent RSA : Zorro22 (avec lequel vous pouvez échanger sur nos forums).
Articles les plus récents :
- 08/06/2022 18:41 - Vladimir Poutine : Il n'y aura que deux vainqueurs. Les USA et la Russie !
- 28/04/2022 17:44 - L'Europe ne doit pas pactiser avec le Diable !
- 04/10/2021 09:04 - Chômage : Combien allez-vous perdre ?
- 04/12/2020 11:17 - Covid & Vaccins, l'appel de Christian Perronne censuré par Google
- 25/09/2020 16:53 - De l’éveil civilisationnel au déclin de l'Occident
Articles les plus anciens :
- 17/06/2020 18:05 - Comment soumettre une nation au Nouveau Désordre Mondial ?
- 02/06/2020 10:37 - Les Français ont plus peur du chômage que du coronavirus
- 11/03/2020 19:53 - Imaginez un Monde où…
- 25/11/2019 14:08 - Comment Amazon fraude le fisc et détruit l'emploi
- 24/10/2019 17:32 - Réinformation : 50 sources dissidentes passées au crible






Commentaires
La CAF persiste à taxer illégalement les allocataires du RSA
Alors que le Conseil d’État a confirmé dans un jugement de juin 2017 l’illégalité du procédé, les caisses d’allocations familiales continuent de surtaxer l’épargne des allocataires du revenu de solidarité active, et ne répondent pas à leur devoir d’information des usagers.
Décidément, les caisses d’allocations familiales (CAF) ont bien du mal à appliquer la loi. En janvier 2017, Mediapart, alerté par des usagers soutenus par l’association Apnée-Actuchomage, révélait que contrairement au code de l’action sociale et des familles, les CAF taxaient à tort les livrets A des allocataires des minimas sociaux. Six mois plus tard, le Conseil d’État a confirmé que cette taxation de l’épargne était illégale, à l’occasion d’un jugement délivré par le tribunal administratif de Montpellier.
Le 17 novembre dernier, la CAF s’est donc, contrainte et forcée, enfin conformée à la jurisprudence et a même édité une circulaire, rappelant à ses agents les règles à appliquer lorsqu’un allocataire possède une épargne. La consigne semble avoir du mal à passer puisque des usagers continuent d’être illégalement «trop taxés», assure l’association Apnée-Actuchomage, qui ferraille sur ce sujet depuis des années.
Les allocataires du RSA n’ont par ailleurs jamais reçu une quelconque information, leur permettant éventuellement de se voir verser rétroactivement des sommes pourtant ponctionnées à tort. Ce faisant, la CAF faillit une deuxième fois à son devoir. Elle est en effet dans l’obligation d’informer les allocataires de leurs droits.
Sur le fond, l’affaire est relativement simple : peu de gens le savent, mais le RSA (revenu de solidarité active) est loin d’être inconditionnel. Les caisses d’allocations familiales prennent en compte pour le calcul d’un RSA l’ensemble des revenus disponibles, y compris les économies épargnées et placées. Un certain nombre de bénéficiaires des minimas sociaux, pas tous, conservent en effet des bas de laine, ce qui n’a rien d’illégal mais doit être déclaré. La plupart des CAF appliquaient jusqu’ici à cette épargne une taxe forfaitaire de 3 %, qu’elles déduisaient ensuite de l’allocation versée chaque mois.
Or les textes précisent que, pour ceux qui possèdent des livrets rémunérés (comme le livret A), la taxation ne doit pas être forfaitaire, mais égale au montant des intérêts, soit 0,75 % pour le livret A, par exemple. Cette confusion réglementaire a pu avoir des conséquences dramatiques : «J’ai touché concrètement 322 euros au lieu de 480 pendant trois mois», expliquait ainsi Pierre (prénom d’emprunt) à Mediapart.
Cet usager a attaqué son département devant le tribunal administratif et attend toujours réparation. Depuis la décision du Conseil d’État, le montant du RSA qu’il perçoit est passé «comme par magie» à son montant légal en janvier 2018, sans que Pierre ne reçoive aucune information de sa caisse. «Les montants précédemment spoliés restent eux toujours à récupérer», précise l’allocataire, tenace.
Dans la circulaire éditée par la CAF, et que Mediapart a pu consulter, les choses sont pourtant écrites noir sur blanc : «Le taux forfaitaire de 3% n’est plus applicable à l’ensemble des livrets d’épargne (…). Par conséquent, pour la détermination des droits au RSA, seul le montant réel des intérêts perçus doit être pris en compte.» Plus loin, la CAF précise que ces nouvelles modalités s’appliquent aux nouvelles demandes, aux droits en cours, mais aussi «sur réclamation, à tous les dossiers ayant fait l’objet d’une évaluation à 3% au titre des produits d’épargne. La régularisation doit être effectuée dans la limite de la prescription biennale».
En langage moins codé, les allocataires dont le RSA a été indument ponctionné peuvent réclamer un “recalcul” sur les deux dernières années. Encore faut-il être informé. Or la déclaration de ressources que doivent remplir chaque trimestre les allocataires n’a jusqu’ici pas été modifiée. De fait, avant que la CAF n’admette publiquement son erreur, les procédures judiciaires étaient rarissimes et les départements peuvent continuer à tabler sur une forme d’inertie des allocataires, perdus face à l’administratio n. «Je sais que peu de gens se lanceront dans une réclamation de crainte de se retrouver dans le collimateur de la CAF… et de subir un contrôle tatillon», confirme Yves Barraud, le président d’Apnée-Actuchomage.
Le manque à gagner – ou les économies, selon le point de vue – peut pourtant s’avérer énorme : lors de l’affaire des «recalculés de l’Unédic», qui a concerné environ 800 000 chômeurs en 2004 et 2005, seule une petite quarantaine de demandeurs d’emploi ont engagé des actions qui, au terme d’une bataille juridique remontée pareillement jusqu’au Conseil d’État, se sont soldées par la réintégration dans leurs droits des 800.000 concernés, soit deux milliards d’euros débloqués par l’État.
L’association s’est fendue le 26 janvier d’une lettre ouverte à Agnès Buzyn, ministre de la santé et des solidarités, ainsi qu’à Vincent Mazauric, directeur général de la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales). «Par manque d’information ou renseignements erronés, des allocataires sont encore à ce jour taxés illégalement et n’ont pas connaissance de la possibilité d’obtenir remboursement (partiel) de la taxation abusive subie», relève l’association, qui évalue à plusieurs millions d’euros les économies réalisées par les départements sur le dos des «précarisés», par cette interprétation erronée du droit. L’association n’a toujours pas reçu de réponse. La CNAF, que Mediapart a également sollicitée sur le sujet, semble muette.
Pour Apnée, d’autres placements (comme les assurances vie ou les plans d’épargne logement…) sont également soumis à une taxation forfaitaire de 3%, alors même que le rendement de ces placements serait inférieur à ce taux. Enfin, le sujet ne semble pas se borner aux allocataires du RSA. Les retraités qui touchent un minimum vieillesse (l’Aspa, environ 800 euros) voient également leurs allocations retranchées s’ils ont des économies placées, sur la même base forfaitaire de 3%.
Les CAF et les départements, qui financent les allocations de solidarité, traînent donc la patte, concentrés qu’ils ont été ces dernières années sur la crainte de passer à côté des revenus «cachés» des bénéficiaires des minimas sociaux. La taxation des revenus de l’épargne a été introduite à la faveur du remplacement du revenu minimum d’insertion (RMI) par le RSA en 2008. La même année, une délégation nationale à la lutte contre la fraude ainsi que des comités départementaux de lutte contre la fraude sociale ont été initiés par décret. «À mesure que ces dispositifs, appuyés sur plusieurs rapports parlementaires, se sont étoffés, les organismes prestataires ont été amenés à durcir leurs modalités de contrôle», souligne un rapport du défenseur des droits, publié fin 2017, qui s’interroge sur le prix que payent les usagers face aux politiques de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
«Au-delà des pratiques, entretenues par une rhétorique de la fraude alimentée par des discours politiques “décomplexés”, ces atteintes [aux droits des usagers – ndlr] s’expliquent aussi, comme l’a montré ce rapport, par la densité, la complexité et le manque de transparence de la réglementation en vigueur ainsi que des procédures qui en découlent», insiste le Défenseur des droits, qui recommande aux organismes de protection sociale de «mettre en œuvre l’obligation d’information à laquelle ils sont tenus». Le flou entretenu sur la taxation de l’épargne des allocataires est, en l’espèce, un véritable cas d’école.
Mathilde Goanec - Mediapart Répondre | Répondre avec citation |